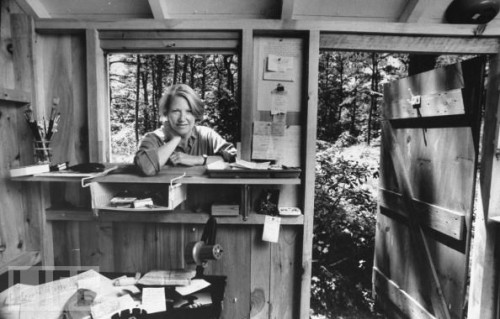La mort d’un enfant est un des sujets les plus douloureux qui soient. Quand un car scolaire se renverse un jour de neige, entraînant deuils, souffrances et déchirements, comment en parler ? Russell Banks, dans De beaux lendemains (The Sweet Hereafter, 1991), donne la parole successivement à Dolorès, la conductrice du car, à un chic type qui y a perdu ses jumeaux, à un avocat qui veut représenter les victimes, à l’une de celles-ci, Nicole, à qui on répète qu’elle a eu de la chance parce qu’elle a survécu, mais qui y a perdu ses jambes, avant de revenir à Dolorès, pour en finir avec cette histoire qui a chamboulé Sam Dent, une bourgade au nord de l’Etat de New York.
Ce matin-là, ça sentait la neige. Dolorès l’a dit à son mari, en chaise roulante à la suite d’une attaque. Cela fait vingt-deux ans que cette grande et forte femme ramasse les enfants et les ramène, matin et soir, par tous les temps. Elle bichonne son bus avant d’entamer sa tournée dans ce village où elle connaît tout le monde, elle trie aussi le courrier à la poste. Elle sait qui arrive toujours en retard, quels drames se cachent derrière de petites mines chiffonnées, elle sait s’y prendre avec les gosses, en fixant clairement les règles au départ, en s’intéressant à eux mais sans insister, pour qu’ils se sentent à l’aise.
Ses passagers et elle sont assez surpris quand le petit Sean, seul enfant du couple qui tient l’unique motel du coin, tend les bras vers sa mère « comme un bébé craintif » en lui disant qu’il veut rester avec elle, avant que Nicole Burnell, une des filles de huitième, le prenne près d’elle pour le rassurer. Plus loin, une fois ses jumeaux dans le bus, Billy Ansel a pris l’habitude de les suivre avec son pick-up, jusqu’à la bifurcation vers la ville – pas envie, sans doute, de se retrouver seul dans la maison depuis que leur mère est morte d’un cancer, quelques années avant. Idéaliste, ancien du Viêt-nam qui embauche régulièrement de jeunes gars « maussades » revenus de cette guerre et les aide à se réhabiliter, Billy est considéré par tous comme un modèle.
On fait donc connaissance avec les enfants, leurs familles, la localité, jusqu’à ce que surgissent les problèmes sur la route, d’abord ce chien qui surprend la conductrice en traversant la route juste devant eux – heureusement il ne se passe rien –, puis ce second chien que Dolorès voit ou croit voir dans la neige tombante et qui la fait braquer à droite et freiner, « tandis que le bus quittait la route et que le ciel basculait et chavirait et que le sol surgissait brutalement devant nous. »
Billy Ansel, derrière, était en train de répondre de la main à ses enfants qui lui faisaient signe de l’arrière. Il a vu l’embardée, le dérapage, le garde-fou enfoncé, le bus « en chute libre du haut de la berge jusqu’au fond de la sablière » et l’eau glaciale en engloutir la moitié arrière. Contrairement aux gens qui prétendaient savoir que cela arriverait un jour ou l’autre, qui accusent Dolorès ou l’état du bus ou l’entretien des routes, à la recherche d’un coupable, il sait que l’accident était imprévisible. A ce moment-là, il s’en veut, lui était en train de fantasmer sur la femme mariée avec qui il entretenait une liaison secrète, et maintenant toute sa vie défile, sa vie avec Lydia, sa femme, leurs vacances avec les enfants, la maladie, le veuvage. Après l’accident, il aide à remonter les survivants, à dégager les corps bleuis. Pas par courage – « Ma seule possibilité de continuer à vivre était de croire que je ne vivais plus. »
Quand Mitchell Stephens aborde Billy Ansel près de son garage, il se fait éconduire, Ansel ne veut aucun contact avec ces juristes qui rôdent dans les parages pour monter une affaire. Mais l’avocat est expérimenté, et ce n’est pas la cupidité qui le fait agir mais la colère, contre ceux qui jouent avec la sécurité, qui sacrifient des vies pour diminuer les coûts, augmenter les gains. Il convainc rapidement quelques familles de lui confier leurs intérêts, puisqu’il ne leur en coûtera rien, sauf un pourcentage sur les dédommagements s’il gagne leur procès. Stephens mène une « vendetta personnelle ». Sa fille unique, Zoé, il n’est pas arrivé à la protéger de la drogue, il n’a de ses nouvelles que quand elle a un besoin urgent d’argent pour continuer, et son amour pour elle s’est transformé en « rogne fumante ».
Russell Banks, écrivain engagé, convainc davantage dans De beaux lendemains que dans La Réserve. C’est la jeune Nicole Burnell, de retour chez elle en fauteuil roulant, dans la chambre que son père lui a aménagée au rez-de-chaussée, où elle demande tout de suite qu’il lui installe un verrou à la porte, qui portera le dénouement de cette douloureuse affaire. L’adolescente s’étonne de l’ordinateur offert par l’avocat à son intention et ne comprend pas ce que ses parents attendent d’un procès. Chanceuse ? Malchanceuse ? Elle comprend qu’elle est « les deux à la fois, comme la plupart des gens ». L’accident l’a transformée de plus d’une façon, et elle est plus forte qu’on ne le croit. Sa famille et tous les autres ne savent pas encore ce qui les attend. Le sait-on jamais ?